Le Soupir de l’immortel d’Antoine Buéno – Version Longue
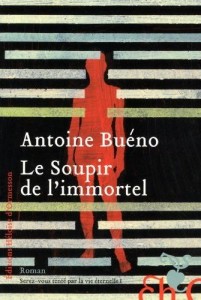 Le Soupir de l’immortel ayant provoqué beaucoup trop d’étincelles dans ma petite tête, j’ai dû me résoudre à produire non pas un, mais deux textes. Un « court » avis mieux structuré, plus impersonnel et qui rentre moins dans les détails. Et le texte ci-dessous, beaucoup plus long avec plein de « je », que j’avais besoin d’écrire pour soulager un peu ma pression intracrânienne. Avis aux amateurs qui n’auront pas peur de se gâcher le plaisir de découvrir le contenu du livre par eux-mêmes.
Le Soupir de l’immortel ayant provoqué beaucoup trop d’étincelles dans ma petite tête, j’ai dû me résoudre à produire non pas un, mais deux textes. Un « court » avis mieux structuré, plus impersonnel et qui rentre moins dans les détails. Et le texte ci-dessous, beaucoup plus long avec plein de « je », que j’avais besoin d’écrire pour soulager un peu ma pression intracrânienne. Avis aux amateurs qui n’auront pas peur de se gâcher le plaisir de découvrir le contenu du livre par eux-mêmes.
Note : il y a des liens sur les étoiles qui renvoient à des notes de « bas de page ». Une flèche permet de remonter ensuite au bon endroit.
Edit du 22/07 : j’ai dû revoir quelques phrases pour dissimuler des maladresses flagrantes.
Quatrième de couverture : L’an 570 après Ford. Le monde est enfin durable et uniformisé. Plus de crise environnementale, plus de guerre, plus de misère. La planète est devenue un Éden ultralibéral, une jungle luxuriante d’humains bigenrés.
Tout ne va pourtant pas pour le mieux. L’immortalité se paye au prix fort.
Entre une histoire d’amour impossible, une enquête policière déconcertante et un complot politique odieux, Le Soupir de l’immortel est un spectaculaire roman d’anticipation, foisonnant et déjanté.
Il n’y a rarement mieux placé qu’un auteur pour faire la promotion de son propre livre. Antoine Buéno, avec qui j’ai eu le plaisir d’échanger à Épinal lors des Imaginales 2012, a eu l’honnêteté de dire que ses œuvres de jeunesse portent bien leur nom et sont à éviter, et que ce qu’il a fait de mieux jusqu’à ce jour, c’est Le Soupir de l’immortel. Quand on est trentenaire et que l’accouchement a pris 10 ans, il est compréhensible qu’on défende son bébé tout en cherchant à le vendre (!!). L’auteur éprouve cependant le besoin de prévenir : le premier chapitre est violent et cru. Et en effet, c’est une entrée en matière saignante et percutante… et surtout très déroutante. J’abordais le livre avec une bonne dose de curiosité, ne serait-ce qu’à cause de la mise en garde susmentionnée, et je me suis rapidement pris une claque. Pas vraiment à cause de ce qu’il s’y déroule, car tant que ça n’implique pas Patrick Bateman, un rat et une femme, je peux supporter beaucoup de choses. C’est surtout parce que je suis de plus en plus sensible au travail d’écriture, et, là, j’ai tout de suite été conquise par le style*. Ensuite, parce que je me suis surprise à rire doucement de choses dont il ne faut pas rire normalement, et, qu’en plus, je n’y pouvais rien. Ce premier chapitre, même s’il est vraiment à mettre à part, a suffi à donner le ton : la forme est ultra travaillée et l’humour politiquement incorrect. J’ai tout de suite su que j’allais aimer le livre, mais je ne m’attendais certainement pas à ce que l’expérience soit aussi profonde (et je pèse mes mots).
Jusqu’à présent, je ne m’étais pas vraiment penchée sur la SF. Comme beaucoup, j’ai lu quelques classiques : Blade Runner, 1984, Le Meilleur des mondes, Dune, Fahrenheit 451… Pas d’Asimov par contre, ce qui ne m’empêche pas de connaître les trois lois de la robotique. J’ai surtout vu un paquet de films. J’avais donc malgré tout quelques clés de compréhension en main qui se sont révélées fort utiles même si elles étaient de loin bien insuffisantes pour apprécier le livre à sa juste valeur. Car Le Soupir de l’immortel regorge et dégorge de références. Un bon nombre servent d’ailleurs à la construction du monde en lui-même, ce qui, dit de cette façon, peut soulever légitimement le problème de l’apport personnel de l’auteur dans tout ça. Ce qui transparaît en réalité, c’est un hommage appuyé à quelques piliers littéraires et cinématographiques du genre. Et c’est à partir de ce socle composite solide qu’il a pris son envol pour développer le reste. C’est parfois délicat de faire la part des choses, mais le résultat est tellement cohérent que, finalement, ça n’entache pas le plaisir de la lecture.
Hormis ces références évidentes et totalement assumées, il y en a une foultitude d’autres qui toucheront plus ou moins le lecteur selon son niveau de culture au sens très très large. Ça va du choix des prénoms et noms des protagonistes (politiques, humoristes, philosophes, penseurs, scientifiques…tout y est représenté) à des allusions à la pop-culture totalement générationnelles qui en laisseront sans doute quelques-uns sur le carreau, en passant par des clins d’œil plus élaborés comme cette belle idée de faire remonter une structure hélicoïdale à un personnage nommé Crick. Buéno se permet même de se faire référence à lui-même. La boucle est bouclée.
C’est tellement vaste qu’il est quasiment impossible de tout saisir du premier coup (pas plus qu’au deuxième ou au cinquième d’ailleurs à mon avis), mais c’est un peu le risque avec une utilisation aussi foisonnante de références comme celle-ci. Je me suis confrontée à mes propres limites sur le sujet de la politique. J’ai compris les discours dans le contexte du livre, et ils sont d’ailleurs d’une limpidité appréciable, mais je sais aussi que je suis bien incapable de prendre un quelconque recul sur le sujet. Si les politiciens sont calqués sur des alter ego bien réels, je ne peux que le soupçonner sans pouvoir aller au-delà. Quelque part c’est assez frustrant de se savoir passer à côté de plein de détails et j’imagine que ça sera le cas pour d’autres sur des sujets différents. Ailleurs, c’est comme une invitation à en savoir plus à la Starship Troopers. Échec d’Alice ?
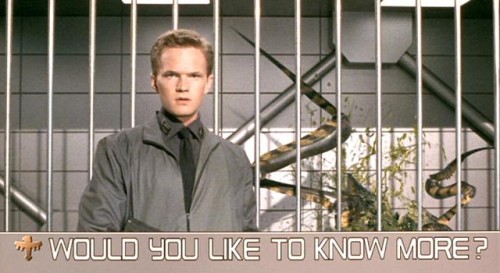
Yes.
Et le fond du livre dans tout ça ? Antoine Buéno est estampillé écrivain prospectiviste. Pour faire simple, il pense le futur, mais pas le futur tel qui souhaiterait qu’il soit ; plutôt le futur tel qu’il pourrait être si on se base sur l’observation du monde d’hier et d’aujourd’hui. L’étape suivante, et le but de la démarche finalement, est de réfléchir à des solutions aujourd’hui pour influer sur le futur à moyen ou long terme, le plus souvent pour contrer un problème de taille (crise énergétique, surpopulation, modification du climat, etc.).
Le Soupir de l’immortel est certes un livre d’anticipation, mais il prend amplement en compte nos problèmes actuels et présente une vision d’un futur tel que la conjonction de plusieurs événements pas si hypothétiques pourrait le générer. Et ce nouveau monde offre un certain nombre de solutions très élaborées qui poussent forcément à se poser encore plus de questions sur l’avenir de l’humanité.
Dans ce monde où, grâce aux progrès de la médecine, les hommes sont devenus immortels, on en vient naturellement à se questionner sur le problème de la surpopulation, et, là encore, il y a une solution proposée : plus de reproduction naturelle, mais des couveuses qui permettent de contrôler le nombre de nouveaux êtres produits sur Terre. Un moyen de contrebalancer au mieux les quelques morts accidentelles et les suicides (même si ceux-ci sont illégaux). La conquête de l’espace permet aussi de gérer les flux et semble être l’une des perspectives d’avenir.
Plus de soucis d’identité sexuelle non plus avec l’humain bigenré qui a en plus moyen de modifier sa propre balance hormonale pour se donner une prédominance mâle ou femelle et ainsi satisfaire son envie du moment. À cela se rajoute une culture de l’hédonisme sexuel et sans tabous développée à outrance qui par un magnifique tour de passe-passe a pris la place de l’opium du peuple de Marx. Sauf que là où ça devient perversement jouissif, c’est que le vocabulaire, lui, n’a pas changé. Les églises sont pleines, les gens prient, communient et véhiculent la bonne parole en partageant leurs orgasmes à travers les boucles de communion. Une solution miraculeuse qui pourrait presque en faire rêver plus d’un.
L’autre avancée de taille est cet implant dont est équipé tout homme dès sa conception. Ne serait-ce que pour l’acquisition d’un socle commun de connaissances, on ne pouvait rêver plus efficace. Mais comment ne pas y voir aussi la menace d’une magnifique porte d’entrée dans l’esprit sous couvert de doter l’homme de capacités de connectivité, de télépathie et d’empathie exacerbées ? Bien sûr le mot éthique est prononcé ; cependant il est difficile de ne pas imaginer les dérives dangereuses qui pourraient découler d’une telle technologie.
Il ne faut pas attendre bien longtemps pour mettre le doigt sur les premières failles de cette société. Là où mes petites cellules grises se sont modestement** emballées, c’est sur l’impact que ces progrès ont eu sur la notion d’individu. Plusieurs personnages du livre soulèvent d’ailleurs le problème. L’humain en est rendu à être issu d’une sélection génétique et à suivre un conditionnement censé mener à un métier pour lequel il est prédestiné, même si on lui laisse encore l’option de se réorienter par la suite. En voulant canaliser au maximum sa pensée grâce à l’implant, il donne fortement l’impression d’être devenu une créature formatée dès la naissance qui n’a que les libertés qu’on veut bien lui faire croire qu’il a. Mais le plus triste c’est qu’il a perdu celle de mourir ; ce qui est un net recul par rapport à aujourd’hui. Je comprends que l’immortel puisse soupirer même si le soupir du titre est autre chose dans le livre. La patate chaude la plus effrayante lancée par l’auteur dans le livre, c’est l’étape suivante : la numérisation de la personnalité qui permettrait à l’homme de partir à la conquête de l’espace en ne transmettant de lui qu’une image virtuelle qui viendrait s’ancrer à l’arrivée dans un réceptacle adéquat. Est-ce que l’humanité ne disparaîtra pas le jour où quelqu’un décidera « À quoi bon nous réincarner dans des enveloppes corporelles. Restons virtuels, c’est tout ce dont nous avons besoin pour être » ? Ce qui résoudrait encore plus de problèmes d’un coup. Mais qu’est-ce qui différenciera alors l’homme des IA si tout le monde devient une forme de programme ? Et pourquoi est-ce que je repense à Matrix tout à coup ?
« Saviez-vous que la première Matrice avait pour dessein de créer un monde parfait, où personne ne souffrirait. Le bonheur parfait pour chaque être humain ! Ce fut un désastre, une catastrophe pour les récoltes.
Certains pensaient que nous devrions reprogrammer l’algorithme du concept de monde parfait. Mais je crois que votre espèce, les humains, définissez la réalité comme une sorte de purgatoire, une souffrance. Le monde parfait était un rêve auquel vous ne pouviez accéder qu’en mourant. C’est pour cela que la Matrice fut remaniée en ceci, l’apogée de votre civilisation. Je dis bien votre civilisation car depuis que nous pensons à votre place, c’est devenu notre civilisation, ce qui en fin de compte nous importe. » Agent Smith.
Ce monde donne l’impression du « mieux » grâce à des avancées médicales, politiques, scientifiques et cette merveilleuse sécurité sociale qui garantit à tous santé, immortalité, travail. Sauf qu’il y a aussi tout ce qui n’a pas changé avec le temps. La nature humaine est toujours capable du meilleur comme du pire, les politiques recourent aux mêmes armes rhétoriques pour manipuler les masses, la société fonctionne toujours à 2 vitesses et l’indicateur de richesse est devenu l’enfant, un bien rare et précieux. Tout est une histoire d’emballage et d’illusions, mais finalement tout n’est jamais pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et ça ne le sera probablement jamais.
En ce moment, pour qu’un livre me séduise, il ne suffit plus qu’il ait une bonne histoire à raconter (ou alors, il faut qu’elle soit sacrément prenante pour me faire oublier le reste). Il faut aussi que le travail d’écriture soit au rendez-vous et qu’il me prenne aux tripes ou qu’il caresse mes circonvolutions cérébrales d’une façon ou d’une autre. Avec Le Soupir de l’immortel, j’ai été servie. En fait, les premiers effets se sont faire ressentir dès la page 28. Le passage qui a retenu toute mon attention se trouve en citation à la fin de ce post. La scène est d’une extrême violence, mais la forme la sublime. C’est une technique que l’auteur va utiliser à de nombreuses reprises tout au long du livre, créant parfois des décalages entre la réalité de la scène et le rendu en mots tout à fait savoureux. L’astuce peut tout autant émerveiller ou perturber que faire rire involontairement. Voire tout en même temps et il en résulte un sentiment d’intense jubilation.
Il y a aussi tous ces moments d’écriture brillants qui m’ont soufflée. En vrac : la visite du Lieu du tout, cet instant où le temps suspend son vol et que l’humanité retient son souffle pages 439 et 440, le passage dans le Jet sur lequel je reviens plus loin… Plus une quantité de phrases, d’expressions et d’idées aux tournures très rafraîchissantes et futées : les petites appellations « polies » des domociles qui sont parfois de magnifiques insultes envoyées en pleine figure, l’image des lois votées représentées par des plans d’orchidées qui envahissent littéralement le Sénat***… Tout ça a fait le plus grand bien à la morosité littéraire dans laquelle je m’étais enfermée depuis quelque temps.
En dehors du réel plaisir que j’ai éprouvé à la lecture pour les raisons invoquées ci-dessus, il y a eu aussi cette impression d’avoir été très en phase avec le contenu par moments. Notamment parce qu’à plusieurs reprises, j’ai anticipé la suite des événements ou le fil de pensée de l’auteur ; probablement à cause de ma lecture hachée par les nombreuses questions qui m’ont traversé l’esprit et du temps que j’ai pris pour y réfléchir. C’est une démarche à double tranchant, mais, dans ce cas, c’était une sensation fort agréable.
Il y a aussi eu cette connexion qui s’est établie avec le personnage de John-Stuart grâce à sa sensibilité, à notre amour de la VO, nos références cinématographiques communes (la Japonaise de Babel, Magnolia). J’ai été très réceptive à ses états d’âme et j’ai aimé qu’il soit le rêveur, l’électron libre qui cherche à échapper à son carcan. La scène qui m’aura sans doute le plus touchée est celle dans le Jet où se cristallise réellement son besoin de ne plus voir le monde tel qu’on le lui impose depuis sa naissance. Pendant que la foule rit bêtement devant le dernier sketch miteux du comique du moment, il regarde la Terre vue du ciel, puis l’infini de l’espace et décrit ce qu’il ressent. C’est à la fois poétique et libérateur.
Et le petit plus qui me fait encore sourire : pour je ne sais quelle raison, le mot bukkaké (attention, c’est inapproprié pour le boulot) me trottait dans la tête depuis le chapitre I alors qu’il n’y avait pas vraiment lieu (ou alors c’est encore mon inconscient au travail). Quelle n’a pas été ma surprise de le voir soudain surgir page 95. Un rien m’amuse.
En fait, il n’y a qu’un seul passage où je me suis sentie violemment déconnectée et où il a fallu que je fasse l’effort conscient de replacer les choses dans le contexte du livre : celui des pédophiles de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet au chapitre III. Un tout petit rien de quelques lignes bien plus délicat à digérer. Surtout que j’ai en permanence un paquet de Dragibus à portée de main et que je le regarde de travers depuis…
La chose que j’ai aussi dû me forcer à faire, c’est aller jeter une oreille sur la playlist fournie par l’auteur à la fin du livre. Quelqu’un s’est d’ailleurs amusé à la reconstituer sur Youtube. Je crois qu’un monde où le Rap serait considéré comme un très bon choix de musique serait vraiment mon pire cauchemar. Fort heureusement, ce livre n’est pas un Vook.
Yal Ayerdhal, lors de la conférence sur la SF qui s’est tenue à Épinal cette année, a dit ceci :
La science-fiction est la seule littérature qui a succédé au rôle que les philosophes se donnaient jusqu’à la fin des années 20. Les auteurs de science-fiction ont réellement pris en charge le devoir de réfléchir l’humanité dans ce qu’elle était et dans la projection de ce qu’elle pourrait être.
Ce qui me paraît de circonstance puisque c’est précisément ce qu’Antoine Buéno fait avec son livre. D’une densité indiscutable, Le Soupir de l’immortel est une réflexion poussée sur l’avenir de l’humanité qui ne laisse rien au hasard et offre une multitude de pistes de lecture. Il s’agit d’un patchwork impressionnant qui touche à tout : politique, économie, amour, sexe, thriller, philosophie, sociologie, technologie, religion, etc. Le tout égayé par cet humour pas piqué des hannetons tout à fait irrésistible qui accentue l’impression de tenir dans ses mains un OLNI qui mérite grandement le détour. C’est aussi une invitation à aller plus loin, à se poser des questions sur le monde qui nous entoure et à explorer d’autres univers. En ce qui me concerne, ça commencera par la lecture de quelques Asimov parce qu’il serait temps. Et comme dirait Maïa Mazaurette : « le pire est avenir ».
* Je trouve absolument génial de dire que j’aime le style de quelqu’un qui a créé un Prix du Style (Ah les petits plaisirs de la vie !) ![]()
** Modestement, parce que, au final, je ne fais que paraphraser des idées déjà présentes dans le livre. S’il n’avait pas eu recours à la ficelle du pathos qui m’a hérissé le poil d’un coup, je pense que j’étais à point pour voter Schrödinger et adopter son chat au passage.![]()
*** Une image qui n’est pas sans évoquer les murs du film The People vs Larry Flint. Je ne parle ici que de la représentation visuelle et pas d’une quelconque similitude au niveau du message transmis. Les orchidées sont bien plus belles que les murs. ![]()
Citations :
P28 : Le passage que j’ai relu deux fois d’affilée en concluant les deux fois par « Wouaw ! »
Et Aldous ouvrit le bal. Il leva bien haut sa batte, comme un chef d’orchestre sa baguette. Un grand silence suivit l’échauffement cacophonique des instruments. Chacun retint son souffle. Et musique, maestro ! Aldous abattit son arme, au hasard. A son signal, toutes les cordes vocales se mirent à vibrer et toutes les belles à tourner, tourner, et encore tourner. Réglé comme du papier à musique. Soulevés par un vent de terreur, les tissus se mêlèrent, se rapprochèrent, se croisèrent par vagues successives. Ce fut un ballet magnifique de voiles, un spectacle de derviches revisité par Pina Bausch. Aldous donna la cadence de la chorégraphie. Jason rythma la symphonie des hurlements, staccato, andante, mezzo forte, forte, fortissimo… Du Beethoven. Au blanc et noir de cette volière d’hirondelles secouée se mêla bientôt le rouge, d’abord par traces impressionnistes, puis par nappes fauves.
P51 : La phrase qui m’a fait exploser de rire (quand je dis que ça n’est politiquement pas correct)
– Eh bien, sans vouloir offenser plus encore votre magnanimité contrariée, je pense que vous n’auriez pas dû assommer votre mère et la sodomiser d’entrée de jeu. Elle aurait pu vous être utile.
P151 : Celle qui fait rêver
La constitutionnalisation du droit au beau temps était dans les tuyaux, mais sa sanction juridique n’était pas évidente.
P223 : La phrase hautement troublante
– Il ne vous a rien confié, une lassitude, un désir de lever le pied, de partir, de changer d’air ?
P245 : Ça ne m’étonne pas de me trouver des affinités avec John-Stuart. On dirait moi.
John-Stuart était un puriste du septième art. Il était l’un des derniers à visionner les films en version originale, en VO. En VO, c’est-à-dire en version externe, comme à l’époque de Ford. Mode de visionnage totalement archaïque. En VO, le film défilait dans le cadre circonscrit d’un écran dont les bords matérialisaient les limites fictionnelles de l’œuvre. Des limites fictionnelles, en conséquence, toujours visibles par le spectateur. Un spectateur pour lequel, hors de l’écran, le monde réel continuait d’être perceptible. Mais, non contente d’inscrire le film dans l’espace, la VO en restreignait aussi drastiquement l’accès sensitif. Le spectateur demeurait d’autant plus extérieur aux scènes présentées que ce mode de visionnage ne faisait appel qu’au minimum de sens requis pour suivre le déroulement d’une production audiovisuelle : la vue et l’ouïe. Aussi la VO ne pouvait-elle être jugée que d’une extrême pauvreté par les contemporains de John-Stuart. D’une extrême pauvreté, mais surtout d’une extrême aridité, d’une extrême exigence. Dans les conditions de la VO, il était difficile « d’entrer » dans le film. Autrement dit, voir une œuvre cinématographique en version originale requérait une véritable participation de la part du spectateur qui ne pouvait pas rester passif et devait s’acquitter d’un effort de concentration, d’imagination. Bref, d’un effort intellectuel. Voir un film en version externe était donc un comble d’élitisme et de snobisme.
P335 : Une phrase magique, sortie de son contexte.
C’était avec eux que, la vieille, elle s’était rendue coupable de prière.
P573 : J’ai déjà dû prononcer au mot près une bonne dizaine de fois la phrase de l’elfe à la fin.
Comme tout cinéphile le sait, un combat d’arts martiaux digne de ce nom se mène à, au moins, trois contre un, et dans les airs. Celui-là ne dérogea pas à la règle. Sixte et les moines sautèrent. Ils restèrent suspendus à dix mètres du sol, jambes battantes. Tout à la fois figé, ralenti et accéléré, le cours du temps semblait pour eux détraqué. Aldous n’en croyait pas ses yeux. Il interrogea Sindarin du regard :
« Oui oui, ça fait toujours un peu bizarre au début, lui répondit l’elfe avec nonchalance. Mais on s’y fait vite. »
Le mot de la fin Je tiens à remercier Ryuichi Sakamoto, Philip Glass et Fiona Apple pour l’accompagnement musical et bien sûr Antoine Buéno pour cette grande séance de torture qu’il m’a offerte sans le savoir.
Préambule
Bienvenue ici,
un certain nombre de posts sont actuellement hors ligne. Ce blog a plus de 20 ans maintenant et, au fil du temps, des liens se sont cassés, des images hébergées ailleurs ont disparu, le grand Internet a bougé, ma vie aussi, et en plus, je suis devenue correctrice entretemps. C'est dire si, aujourd'hui, ce blog a besoin d'un grand nettoyage de printemps.
Même si je ne poste plus autant qu'avant, c'est un lieu précieux pour moi.
En septembre 2024, j'ai refait la déco. Viendra ensuite la mise à jour du contenu. Un travail long et fastidieux puisque j'ai accumulé près de 2800 posts. Je donnerai la priorité aux avis, puis le reste suivra petit à petit.
Bonne visite !
Catégories
Archives
Rechercher
Bouilloire's books






À propos de moi
Qui : Heidi (博蒂)
Contact : bouilloire[at]gmail[dot]com
Bloggercode : B9 d t+ k s++ u-- f i- o+ x+ e l c-
En manque d'idées pour un cadeau ?

![Brainstorm Seduction 3 [Nōnai Poizun Berī 3]](https://i.gr-assets.com/images/S/compressed.photo.goodreads.com/books/1454943409l/28961280._SY75_.jpg)



